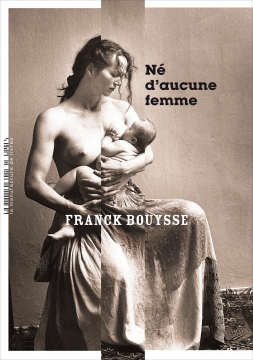« Les classiques, c’est fantastique » certes, mais je n’étais pas forcément inspiré par la thématique de février : l’amour. Cependant, j’ai eu l’idée de profiter de cette occasion pour l’aborder par un genre que je lis assez peu, à savoir le théâtre. C’était l’occasion de lire ou relire des pièces cultes d’auteurs différents. J’ai sorti mes énormes intégrales de leur bibliothèque et j’ai alterné les comédies et les drames, les pièces en vers et en prose.

Je ne vous propose pas une étude comparée de ces différentes pièces (je n’ai ni l’intelligence, ni les connaissances, ni l’envie de consacrer le temps nécessaire à ce genre d’exercice), mais de courts avis de néophyte.
***
Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux (1730)
 Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Sylvia et Dorante doivent se marier. Seulement, comment connaître le vrai visage de l’autre, sans faux-semblants et hypocrisie ? Sans le savoir, tous deux fomentent le même projet : échanger leur place avec celle qui de son valet, qui de sa servante.
Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Sylvia et Dorante doivent se marier. Seulement, comment connaître le vrai visage de l’autre, sans faux-semblants et hypocrisie ? Sans le savoir, tous deux fomentent le même projet : échanger leur place avec celle qui de son valet, qui de sa servante.
L’histoire m’était connue – je crois même l’avoir vue jouée – donc je n’ai eu aucune surprise quant à l’intrigue.
Après les premières lignes, retrouvailles avec un style littéraire très travaillé, tant dans les tournures de phrases que dans le vocabulaire, j’ai pris plaisir à ce beau langage. Les bons mots, les joutes verbales des personnages, les répliques qui fusent m’ont séduite, moi qui n’ai aucune répartie.
La pièce est pleine de quiproquos qui ont su me faire sourire. Elle joue évidemment avec les conditions sociales : les travestissements et les troubles induits par une condition supposée inférieure ou supérieure donnent du corps à l’histoire.
Certes, le tout manque peut-être un peu de nuances – les maîtres intelligents et les serviteurs un peu frustes (surtout Arlequin, le valet de Dorante) – mais, dans ce contexte de pièce classique du XVIIIe, cela ne m’a pas dérangée et j’ai aimé suivre ces deux intrigues parallèles.
J’ai particulièrement apprécié cette figure paternelle qui, bien que souhaitant conclure ce mariage, se révèle gentille, compréhensive et soucieuse du bonheur de sa fille. C’est pourquoi il accepte d’être le complice de la mascarade des deux jeunes gens, Tolérant, il n’impose nullement le mariage et un époux à sa fille.
Une pièce efficace, agréable et divertissante.

« Monsieur Orgon : Va, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l’être assez. »
Le jeu de l’amour et du hasard, Marivaux (1730 pour la première représentation). Dans : Théâtre complet de Marivaux, aux éditions Famot, 1975, pp 419-445.
***
Phèdre, de Jean Racine (1677)
 Résumé minimaliste : Phèdre, femme de Thésée, est amoureuse du fils de celui-ci, Hippolyte.
Résumé minimaliste : Phèdre, femme de Thésée, est amoureuse du fils de celui-ci, Hippolyte.
Il s’agissait cette fois d’une relecture d’un texte adoré voilà longtemps. Pas de suspense : ce fut encore le cas.
L’ambiance est ici complètement différente de la première pièce. Phèdre est une femme mise à la torture par un amour qu’elle réprouve. Seulement, nul ne peut lutter contre les dieux, contre son sang. Après la passion inspirée à sa mère Pasiphaé pour un taureau – passion qui donna vie au Minotaure –, après les malheurs de sa sœur Ariane, abandonné par le même Thésée dont elle est l’épouse actuelle, c’est elle qui est frappée par la main d’Aphrodite.
Ainsi, Phèdre doit se battre contre un destin que – la tragédie étant ce qu’elle est – l’on sait évidemment inéluctable. La pièce ne cesse de s’assombrir et la mort semble planer de plus en plus bas au fil des actes et des scènes.
Outre la notion de fatalité, Racine offre à son héroïne un maelström poignant d’émotions violentes. Elle éprouve tour à tour la honte, le dégoût de soi, la culpabilité, puis s’ajoute la souffrance de voir son amour rejeté en même temps que sa fierté est bafouée.
Le texte est rédigé en vers, en alexandrins, et c’est tout simplement magnifique. J’ai été emportée par cette poésie, par cette souffrance, par ces malédictions jetées au ciel, par ces destinées implacables.
Un coup de cœur une fois encore pour cette histoire mythologique, pour cette pièce emplie de désespoir, pour ce personnage complexe, pour cette écriture superbe.
« Œnone :
Quoi ! de quelques remords êtes-vous déchirées ?
Quel crime a pu produire un trouble si pressant ?
Vos mains n’ont point trempé dans le sang innocent ?
Phèdre :
Grâces au ciel, mes mains ne sont point criminelles.
Plût aux dieux que mon cœur fût innocent comme elles !
Œnone :
Et quel affreux projet avez-vous enfanté
Dont votre cœur encor doive être épouvanté ?
Phèdre :
Je t’en ai dit assez : épargne-moi le reste.
Je meurs, pour ne point faire un aveu si funeste.
Œnone :
Mourez donc, et gardez un silence inhumain ;
Mais pour fermer vos yeux cherchez une autre main.
Quoiqu’il vous reste à peine une faible lumière,
Mon âme chez les morts descendra la première ;
Mille chemins ouverts y conduisent toujours,
Et ma juste douleur choisira les plus courts.
Cruelle ! quand ma foi vous a-t-elle déçue ?
Songez-vous qu’en naissant mes bras vous ont reçue ?
Mon pays, mes enfants, pour vous j’ai tout quitté.
Réserviez-vous ce prix à ma fidélité ? »
« Phèdre :
Ah, cruel ! tu m’as trop entendue !
Je t’en ai dit assez pour te tirer d’erreur.
Eh bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur :
J’aime ! Ne pense pas qu’au moment que je t’aime,
Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même ;
Ni que du fol amour qui trouble ma raison
Ma lâche complaisance ait nourri le poison ;
Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m’abhorre encor plus que tu ne me détestes.
Les dieux m’en sont témoins, ce dieux qui dans mon flanc
Ont allumé le feu fatal à tout mon sang ;
Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle
De séduire le cœur d’une faible mortelle.
Toi-même en ton esprit rappelle le passé :
C’est peu de t’avoir fui, cruel, je t’ai chassé ;
J’ai voulu te paraître odieuse, inhumaine ;
Pour mieux te résister, j’ai recherché ta haine.
De quoi m’ont profité mes inutiles soins ?
Tu me haïssais plus, je ne t’aimais pas moins ;
Tes malheurs te prêtaient encor de nouveaux charmes. »
Phèdre, Jean Racine (1677 pour la première représentation). Dans : Œuvres complètes de Racine, aux éditions Famot, 1975, pp 321-345.
***
Don Juan ou le Festin de Pierre, de Molière (1665)
 (L’orthographe « Dom Juan » semble plus courante, mais mon édition ayant fait le choix du « Don Juan », j’en ferai de même.)
(L’orthographe « Dom Juan » semble plus courante, mais mon édition ayant fait le choix du « Don Juan », j’en ferai de même.)
Malgré la célébrité de cette pièce, je n’en connaissais pas du tout le détail, si ce n’est, évidemment, qu’elle met en scène un coureur de jupons invétéré.
Certes, Don Juan possède des côtés assez sympathiques : il est bon vivant, il a sa propre philosophie de vie et refuse de suivre aveuglément la morale et les préceptes religieux. Cependant, il est aussi fort exaspérant – notamment par son côté séducteur poussé à son paroxysme. C’est un bonimenteur qui n’hésite pas à se marier à droite à gauche sans considération pour ses victimes qui perdent tout intérêt à ses yeux dès lors qu’elles lui ont cédé.
Si certaines scènes sont assez cocasses dans leur ridicule – comme celle où il promet la lune à une paysanne trente secondes après leur rencontre et dix minutes après avoir fait les mêmes promesses à une autre – et si d’autres présentent des réflexions intéressantes, la pièce présente toutefois des longueurs à mes yeux. Un schéma répétitif se met en place au fur et à mesure que les personnages défilent pour blâmer et mettre en garde un Don Juan qui n’écoute personne.
D’ailleurs, la fin voit la réalisation des funestes prophéties ignorées par Don Juan et signe ainsi le triomphe de la morale. Triomphe peut-être atténué par le fait que Don Juan soit resté fidèle jusqu’au bout à son caractère et à ses convictions…
Même si cette pièce m’a moins séduite que les précédentes, ce ne fut pas une lecture inintéressante bien que suscitant des émotions diverses, ni un mauvais moment, et je l’ai lue sans déplaisir.

« Don Juan :
Quoi ! tu veux qu’on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu’on renonce au monde pour lui, et qu’on n’ait plus d’yeux pour personne ? La belle chose de vouloir se piquer d’un faux honneur d’être fidèle, de s’ensevelir pour toujours dans une passion, et d’être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux ! Non, non, la constance n’est bonne que pour des ridicules ; toutes les belles ont droit de nous charmer, et l’avantage d’être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu’elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J’ai beau être engagé, l’amour que j’ai pour une belle n’engage point mon âme à faire injustice aux autres ; je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. »
Don Juan ou le Festin de Pierre, Molière (1665 pour la première représentation). Dans : Œuvres complètes de Molière, aux éditions Famot, 1975, pp 347-375.
***
Roméo et Juliette, de William Shakespeare (environ 1597)
Le résumé est-il nécessaire ? Deux familles qui se haïssent et, au milieu, un couple de jeunes amoureux.
Classique parmi les classiques, incontournable histoire d’amour, couple tragique par excellence ! Je ne pouvais pas ne pas saisir cette opportunité de découvrir cette pièce. Cependant, je dois avouer qu’il s’agit incontestablement de celle contre laquelle j’avais le plus de préjugés. Non pas que je n’avais pas envie de la lire – au contraire, j’étais assez curieuse finalement – mais j’étais prête à ne pas accrocher du tout.
Or, ce ne fut pas du tout aussi niais que je le craignais.
Certes, il y a bien l’histoire du coup de foudre qui me laisse toujours dubitative (surtout que dans le cas de ce coup de foudre, Roméo était masqué…), mais c’est du théâtre, les personnages ne peuvent guère prendre trois siècles pour tomber amoureux, surtout qu’ils doivent beaucoup souffrir après ça. En outre, à l’époque, le public n’était probablement pas aussi blasé que moi. Et puis, tous deux sont jeunes, ce qui peut expliquer son amour absolu et sans concession
Certes, Roméo ne m’a séduite. Déjà, le mec qui tombe fou amoureux de Juliette d’un regard alors qu’il passe le début de la pièce à pleurer sur une autre… Et puis, le gars qui tue le cousin de sa dulcinée deux heures après un mariage secret, alors qu’il sait que la situation est déjà bien tendue et que le prince local en a un peu ras-la-casquette de leurs accrochages plus ou moins mortels… Il cherche quand même.
Par contre, étonnamment, j’ai trouvé Juliette très sympathique et courageuse. Elle brave sa famille, elle fomente un plan d’évasion, elle prend un narcoleptique qui la plonge dans un état proche de la mort, elle se poignarde, le tout sans flancher. Finalement, je crois que Roméo m’a semblé plus pleurnichard que Juliette, ce qui fut une vraie surprise car les personnages féminins dans les classiques ne sont pas toujours fantastiques.
En outre, j’ai finalement été prise sans difficulté dans cette histoire et j’en ai suivi les rebondissements avec plaisir. Cette pièce prônant le mariage d’amour plutôt que les unions arrangées et cette intrigue d’enfants payant le prix de l’inimité de leurs parents a su attraper et conserver mon attention.
Ainsi, je dois avouer que cette lecture – ma seconde pièce shakespearienne – fut une bonne surprise.
« Juliette :
Ô Roméo ! Roméo ! pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et abdique ton nom ; ou, si tu ne le veux pas, jure de m’aimer, et je ne serai plus une Capulet.
Roméo, à part :
Dois-je l’écouter encore ou lui répondre ?
Juliette :
Ton nom seul est mon ennemi. Tu n’es pas un Montague, tu es toi-même. Qu’est-ce qu’un Montague ? Ce n’est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d’un homme… Oh ! sois quelque autre nom ! Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s’appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu’il possède… Roméo, renonce à ton nom ; et, à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi toute entière. »
Roméo et Juliette, William Shakespeare (environ 1597 pour la première représentation). Dans : Théâtre complet de Shakespeare, aux éditions Famot, 1975, pp 323-357. Traduit par François-Victor Hugo.
***
J’avais d’autres titres en tête avant de commencer mes lectures, mais j’ai finalement eu envie de changer d’air en retrouvant mes chers romans. Toutefois, je note de songer plus souvent à tirer une pièce de théâtre de mes étagères.
De ma lecture mitigée de Don Juan au coup de cœur renouvelé de Phèdre, j’ai été marquée par l’efficacité de ces pièces vieilles de plusieurs siècles qui restent finalement très modernes.
J’ai pris beaucoup de plaisir à les lire et j’espère ne pas vous avoir trop ennuyé·es avec ces très modestes chroniques.
Et vous, quelles sont vos pièces favorites,
qu’elles parlent ou non d’amour ?





 Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Sylvia et Dorante doivent se marier. Seulement, comment connaître le vrai visage de l’autre, sans faux-semblants et hypocrisie ? Sans le savoir, tous deux fomentent le même projet : échanger leur place avec celle qui de son valet, qui de sa servante.
Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Sylvia et Dorante doivent se marier. Seulement, comment connaître le vrai visage de l’autre, sans faux-semblants et hypocrisie ? Sans le savoir, tous deux fomentent le même projet : échanger leur place avec celle qui de son valet, qui de sa servante.
 Résumé minimaliste : Phèdre, femme de Thésée, est amoureuse du fils de celui-ci, Hippolyte.
Résumé minimaliste : Phèdre, femme de Thésée, est amoureuse du fils de celui-ci, Hippolyte. (L’orthographe « Dom Juan » semble plus courante, mais mon édition ayant fait le choix du « Don Juan », j’en ferai de même.)
(L’orthographe « Dom Juan » semble plus courante, mais mon édition ayant fait le choix du « Don Juan », j’en ferai de même.)



 Après
Après  Célia, rapidement rejointe par sa mère, vient s’installer dans la maison de feue sa grand-mère dans un village isolé dans les montagnes. Mais leur retour ne plaît pas à tout le monde et remue les cendres du passé.
Célia, rapidement rejointe par sa mère, vient s’installer dans la maison de feue sa grand-mère dans un village isolé dans les montagnes. Mais leur retour ne plaît pas à tout le monde et remue les cendres du passé.