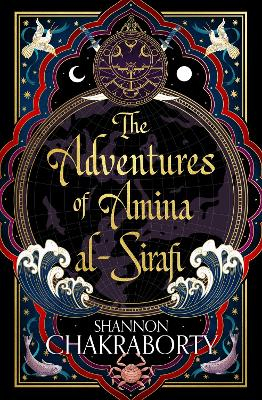 La légendaire pirate Amina al-Sirafi a disparu depuis dix ans. Dix ans de retirement avec sa fille, loin des dangers, des aventures et du surnaturel. Une décennie de calme relatif qui s’achève brusquement quand une femme vient lui demander de retrouver sa petite-fille kidnappée par un Chrétien venu d’Europe, avec des arguments sentimentaux et financiers qu’Amina ne peut refuser. Mais sa quête la mènera plus loin qu’un simple enlèvement.
La légendaire pirate Amina al-Sirafi a disparu depuis dix ans. Dix ans de retirement avec sa fille, loin des dangers, des aventures et du surnaturel. Une décennie de calme relatif qui s’achève brusquement quand une femme vient lui demander de retrouver sa petite-fille kidnappée par un Chrétien venu d’Europe, avec des arguments sentimentaux et financiers qu’Amina ne peut refuser. Mais sa quête la mènera plus loin qu’un simple enlèvement.
Avec ce roman, j’ai aimé…
… lire en anglais. Je ne le fais pas assez souvent finalement alors que je me régale. Même si 500 pages est, je pense, la longueur maximale (parce que ça me demande vraiment beaucoup de temps), le vocabulaire était dans mes cordes (une fois à jour sur certains termes liés aux bateaux, seuls les termes arabes ont nécessité une recherche systématique) et je ne me suis pas lassée. L’écriture est très fluide, essentiellement tournée vers les personnages, mais offre également quelques descriptions très visuelles (comme celle de la cité d’Aden par exemple).
… la rencontre avec Amina. Voguer aux côtés d’une femme, qui est capitaine pirate et exploratrice, mère, amante, musulmane, quadragénaire, croyante mais « a sinner very much relying on the “Most Merciful” aspect of [her] Lord », rêvant d’horizons lointains. Elle est complexe, imparfaite, parfois partagée entre ces différentes facettes, mais, bien que chérissant sa fille, la maternité ne prend pas le dessus sur son identité et ses rêves. Et elle change des personnages que j’ai majoritairement croisés jusque-là…
Avec ses côtés, on part à la recherche de ses anciens camarades, sa famille de cœur, aux caractères aussi variés que sympathiques, ainsi que d’une figure du passé qu’Amina aurait aimé oublier.Un ressort classique, mais qui fonctionne bien, d’autant que j’étais très curieuse de ce personnage et de ce qu’il avait à offrir.
… l’univers qui nous entraîne dans l’Océan Indien, sur les côtes du Yémen et de la Somalie. L’une des nombreuses régions du monde dont je connais peu l’Histoire et qui est ici présentée dans une version alternative, teintée de fantastique. Un monde dans lequel les djinns, les esprits, les monstres immémoriaux et les légendes n’ont pas été chassés par la rationalité. Un univers fantastique dans lequel un peu de diversité peut être injectée.
… l’intrigue et la narration efficace. En sortant de sa retraite, Amina réveille le passé qui se dévoile peu à peu. Il y a un bon mélange d’aventures et de moments plus posés, l’immersion est facile et offre un excellent moment de divertissement. Ce tome peut se suffire à lui-même (avec une fin un peu ouverte certes), mais je n’exclue pas de lire la suite.
Finalement, un reproche global : j’aurais apprécié que le roman soit plus sombre, plus mature peut-être, plus à l’image d’un personnage comme Amina. Qu’il y ait plus de retournements de situations, de personnages troubles, que ces derniers ne soient pas aussi facilement attachants ou détestables en fonction de leur position dans l’histoire. Que le côté pirates – sans en faire nécessairement des personnages assoiffés de sang – soit davantage présent (peut-être que, quoi que dise l’histoire, quels que soient les mots utilisés par Amina, la soif d’exploration ressort davantage que la piraterie). Que l’histoire d’Asif – si longtemps évoquée à demi-mots – ne soit pas balayée aussi rapidement. Que la fin ne dégage pas un léger sentiment de facilité et de « finalement, il n’y avait pas vraiment de quoi s’en faire »…
Un récit dynamique et très plaisant à découvrir auquel manquait sans doute une touche d’ambivalence et de complexité.
« For this scribe has read a great many of these accounts and taken away another lesson: that to be a woman is to have your story misremembered. Discarded. Twisted. »
« But on the occasions that I did capture ships, met me tell you : I could judge the wealth of a passenger by their outrage. By their fury. Men and women who were more offended at the audacity of a poor local demanding a cut of the riches they built on our sea than by the possibility of losing their lives. How dare we? Did we not know that our place was to shut up and stay silent? To beg at the masjid if decades of ferrying them from place to place, diving for their pearls, and making their goods left us crippled. To hush our starving children when they travel past our reed huts draped in jewels and silks. To bite our tongues when the traveling scholars who owe their lives to our boats toss the food we’ve prepared them in the sea because they deem it unclean.
For the greatest crime of the poor in the eyes of the wealthy has always been to strike back. To fail to suffer in silence and instead disrupt their lives and their fantasies of a compassionate society that coincidentally set them on top. To say no. »
« “Part of you must be overjoyed to be a nakhuda again.”
Yes. However, it wasn’t until Nasteho said it that I really let myself accept that truth – guilt had kept me fram making the same connection. For how coult I enjoy being on the Marawati if it kept me from Marjana? Especially on a mission so dangerous? »
The Adventures of Amina al-Sirafi, Shannon Chakraborty. HarperVoyager, 2023. En anglais. 483 pages.
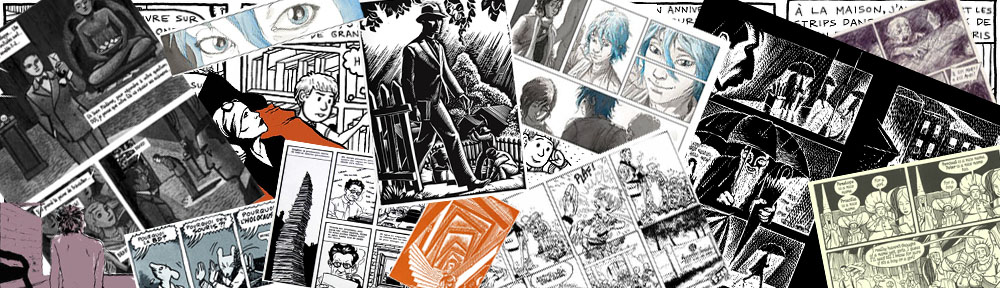

 The Wonderful Wizard of Oz, ou Le magicien d’Oz, est un livre – et un film – dont je ne savais pas grand-chose : Dorothy transportée du Kansas à un pays merveilleux par une tornade, un épouvantail, un homme en fer-blanc, un lion peureux et une méchante sorcière quelque part.
The Wonderful Wizard of Oz, ou Le magicien d’Oz, est un livre – et un film – dont je ne savais pas grand-chose : Dorothy transportée du Kansas à un pays merveilleux par une tornade, un épouvantail, un homme en fer-blanc, un lion peureux et une méchante sorcière quelque part.





 Pour commencer, je reconnais ma surprise en découvrant que The Jungle Book est en réalité un recueil de nouvelles et plus encore que trois seulement mettaient en scène Mowgli, Bagheera, Baloo et compagnie ! Parmi les sept autres, trois se déroulent également en Inde, mais au milieu, une nouvelle dénote particulièrement en racontant les aventures d’un phoque blanc à travers les océans.
Pour commencer, je reconnais ma surprise en découvrant que The Jungle Book est en réalité un recueil de nouvelles et plus encore que trois seulement mettaient en scène Mowgli, Bagheera, Baloo et compagnie ! Parmi les sept autres, trois se déroulent également en Inde, mais au milieu, une nouvelle dénote particulièrement en racontant les aventures d’un phoque blanc à travers les océans. Pourquoi – pourquoi ? – ce livre a-t-il dormi dans ma PAL depuis deux ans et demi – comme me le rappelle impitoyablement le ticket de caisse de Waterstones glissé à l’intérieur – alors que mon amour pour l’œuvre de Sarah Crossan n’est plus à prouver ? Cette question, que je me pose pour plus de la moitié des livres de ladite PAL, n’aura jamais de réponse précise.
Pourquoi – pourquoi ? – ce livre a-t-il dormi dans ma PAL depuis deux ans et demi – comme me le rappelle impitoyablement le ticket de caisse de Waterstones glissé à l’intérieur – alors que mon amour pour l’œuvre de Sarah Crossan n’est plus à prouver ? Cette question, que je me pose pour plus de la moitié des livres de ladite PAL, n’aura jamais de réponse précise.