Je voulais lire ce roman depuis sa sortie et c’est le prix des Aventuriales qui m’a donné l’occasion de le lire. Après deux flops, qu’en a-t-il été de celui-ci ?
***
Les cinq titres en lice :
La cité diaphane, d’Anouck Faure ;
La trilogie du singe, de Pierre Léauté ;
La cité sous les cimes, de Marge Nantel ;
Dolls, de Népenth S. et MoonE ;
Crimes surnaturels, T1, Chaudron de bruyère, de Pauline Sidre.
***
 Depuis sept ans, Roche-Étoile est une cité abandonnée, ravagée par un mal étrange qui a empoisonné toutes les sources d’eau, ville muette peuplée des statues de la déesse sans visage. Une nécropole que vient réveiller un archiviste missionné par un royaume voisin pour en percer les mystères.
Depuis sept ans, Roche-Étoile est une cité abandonnée, ravagée par un mal étrange qui a empoisonné toutes les sources d’eau, ville muette peuplée des statues de la déesse sans visage. Une nécropole que vient réveiller un archiviste missionné par un royaume voisin pour en percer les mystères.
J’ai été happée par l’approche de la cité, par ce travelling avant qui prend son temps, par l’ambiance qui s’installe par des rencontres troublantes ou des bruits inexpliqués. Seulement, un cheveu est tombé dans la soupe…
Dès la première page, le narrateur nous explique qu’il va nous raconter les événements des jours précédents tels qu’il les a vécus « c’est-à-dire dans l’ignorance la plus totale des ressorts qui se jouaient ». Soit. Sauf que, dès lors, il multiplie les effets d’annonce, à coup de « Qu’il m’est étrange à présent de repenser à cette première rencontre… » ou de « Cela m’amuse en y repensant, mais sur l’instant, je regrettai aussitôt mes paroles. ». Une fois, deux fois, passe encore, mais cela se reproduit tant et tant que le mystère a perdu de son attrait au profit d’une immense lassitude. Tout ce que j’avais en tête était : « Mais crache ta pastille, bon sang ! ».
Par la suite, il continue de trouver des stratégies pour repousser les explications (« Pourquoi, vous demandez-vous sans doute. Comment ? Tout cela doit vous paraître très obscur, mais rassurez-vous, vous saurez bientôt. Pas tout de suite, cependant. Nous sommes déjà au beau milieu d’un récit qu’il serait dommage d’interrompre. »). Je n’ai pas besoin de tout savoir tout de suite, mais ces louvoiements me semblaient faux et creux, générateurs de longueurs inutiles.
À ce stade, je l’avoue, j’étais exaspérée et à deux doigts de laisser tomber.
Merci les Aventuriales, j’ai persévéré.
Par la suite, mon intérêt est revenu jusqu’à être bien prise par le récit. L’écriture est soignée, c’était globalement un plaisir de plonger dans les mots de l’autrice. Au-delà des décors gothiques, il y a un côté médiéval à travers les personnages désignés (pour une bonne raison) par leur condition (la chevaleresse, le mendiant, l’archiviste…). J’ai alors apprécié la manière d’aller de mystère en mystère, de rebondissements en retournements de situation. Les révélations sont progressives (sans pour autant tourner en rond) tandis que se dévoilent les motivations des différents personnages. Oscillant entre perfidie et protection, haine et amour, calcul et instinct, le récit s’amuse à nous balader gentiment à travers une histoire qui se révèle comme à rebours. Cependant, je vais être honnête, je doute que les détails de l’intrigue me marquent longtemps : bon nombre de confrontations n’étaient tout simplement pas à la hauteur des décors.
Car j’ai surtout savouré l’atmosphère quelque peu dichotomique du roman. Il a quelque chose d’éthéré – à travers l’architecture blanche et élancée de la cité, l’allure arachnéenne des enfants royaux, la condition ectoplasmique d’un protagoniste… – qui vient se heurter à une matérialité crue, à une chair démesurée, à des monstruosités magnifiées, à un macabre aussi poisseux que sublimé. Et en même temps, il y a ce jeu permanent de faux-semblants, de visages multiples, d’incertitudes, qui évite tout manichéisme.
Finalement, davantage que le fond qui parfois tourne en rond et manque de profondeur et de puissance, je saluerai surtout la forme originale du roman – complété par les gravures sombres de l’autrice – ainsi que l’atmosphère fascinante tout à la fois troublante, malsaine et onirique.
Source des gravures : le site d’Anouck Faure
« Peut-être éprouvèrent-ils du vertige à imaginer les ténèbres d’un esprit sans image. »
« La créature lui inspirait sans doute un mélange de fascination et de répugnance, comme un reflet déformé et pourtant beaucoup trop juste. La corne sur ce front de porcelaine, les membres chevalins lui rappelaient ce qu’il avait été, ce qu’il était désormais. Une licorne noire, un monstre, un être plus tout à fait humain qui se tenait sur les rivages de la mort. »
La Cité diaphane, Anouck Faure. Éditions Argyll, 2023. 261 pages.
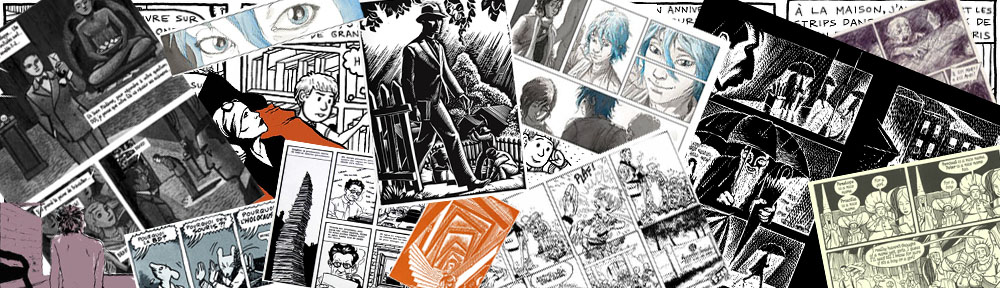


 Vern a fui la secte qui l’a vue grandir, le prêcheur devenu son mari, elle a fui dans la forêt pour y élever ses jumeaux sans influence extérieure. Cependant, traquée et torturée par des changements physiques qu’elle n’explique pas, elle va devoir quitter ce refuge. Le début d’un voyage pour comprendre le passé et espérer survivre au futur.
Vern a fui la secte qui l’a vue grandir, le prêcheur devenu son mari, elle a fui dans la forêt pour y élever ses jumeaux sans influence extérieure. Cependant, traquée et torturée par des changements physiques qu’elle n’explique pas, elle va devoir quitter ce refuge. Le début d’un voyage pour comprendre le passé et espérer survivre au futur. Ce recueil contient trois nouvelles uchroniques. La première, « La grande brisure », nous emmène au début du XVIIIe siècle dans une aventure maritime dans un monde où la Bretagne a été séparée du royaume de France par un séisme et constitue à présent une nation distincte et adverse. « Kaiser Kong », la seconde, réécrit l’histoire du nazisme et du franquisme avec une dose de fantastique en y insérant King Kong et le petit-fils de Frankenstein. Dans la dernière, « Code noir », se croisent Mesrine, Kennedy et Marilyn Monroe, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan dans une France où l’esclavage est toujours en place.
Ce recueil contient trois nouvelles uchroniques. La première, « La grande brisure », nous emmène au début du XVIIIe siècle dans une aventure maritime dans un monde où la Bretagne a été séparée du royaume de France par un séisme et constitue à présent une nation distincte et adverse. « Kaiser Kong », la seconde, réécrit l’histoire du nazisme et du franquisme avec une dose de fantastique en y insérant King Kong et le petit-fils de Frankenstein. Dans la dernière, « Code noir », se croisent Mesrine, Kennedy et Marilyn Monroe, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan dans une France où l’esclavage est toujours en place. Félicité et Agonie sont sœurs. L’une est passeuse de fantôme, l’autre sorcière. Depuis trente ans, tout contact est rompu entre elles, jusqu’à ce que la mort de leur mère les réunisse. Ensemble, elles se lancent sur les traces de leur mère, leur incompréhensible mère, pour retrouver son fantôme, pour lui poser les questions toujours muselées, pour lui permettre d’achever son ultime phrase.
Félicité et Agonie sont sœurs. L’une est passeuse de fantôme, l’autre sorcière. Depuis trente ans, tout contact est rompu entre elles, jusqu’à ce que la mort de leur mère les réunisse. Ensemble, elles se lancent sur les traces de leur mère, leur incompréhensible mère, pour retrouver son fantôme, pour lui poser les questions toujours muselées, pour lui permettre d’achever son ultime phrase. J’apprécie toujours la découverte d’un nouvel ouvrage de Brian Selznick et je me remercie Babelio de m’en avoir une nouvelle fois donné l’opportunité.
J’apprécie toujours la découverte d’un nouvel ouvrage de Brian Selznick et je me remercie Babelio de m’en avoir une nouvelle fois donné l’opportunité.

