La porte, de Magda Szabó (1987)
 Telle une longue confession de la narratrice, ce roman retrace sa rencontre et son amitié avec Emerence, une domestique à la fois concierge et bonne. Aussi différentes que possible, toutes deux vont nouer une relation unique.
Telle une longue confession de la narratrice, ce roman retrace sa rencontre et son amitié avec Emerence, une domestique à la fois concierge et bonne. Aussi différentes que possible, toutes deux vont nouer une relation unique.
Autant j’ai adoré ce roman, autant je serais bien incapable d’en parler pendant des lignes et des lignes, d’où cette mini-critique. Si c’est une confession, c’est aussi un long portrait de près de trois cent cinquante pages. Emerence… voilà un personnage que je n’oublierai pas de sitôt. Paradoxale Emerence ! D’une tyrannie qui n’a que d’égal sa générosité, elle est d’une intelligence acérée tout en revendiquant son mépris pour les intellectuels et sa fierté pour son illettrisme. Singulière et surprenante, elle est capable de conclure une conversation pleine de confidences par un « Bon allez-vous-en, je vous ai assez vue ». Le prénom Emerence vient du latin « emerere » qui signifie « mériter » et elle le porte bien ce prénom, cette femme prête à se mettre en quatre pour les autres, nourrissant les malades, travaillant comme quatre, cachant ceux qui sont pourchassés. Pourtant, j’ai eu du mal à la voir comme la sainte que semblent voir en elle ses voisin·es. Son côté théâtral, ses explosions de violence envers Viola, le chien de la narratrice qui lui est totalement dévouée, sa méchanceté perverse amenaient sa compagnie aux frontières du malsain.
Au fil des pages, on s’interroge : peut-on vraiment connaître quelqu’un ? Faut-il aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé ? Emerence était une personne complexe, elle apparaît parfois pleine de contradictions. Elle avait des secrets, à commencer par ceux qu’elle cachait derrière sa porte que seul le chien de la narratrice était autorisé à franchir. Ma relation avec ces deux personnages n’a cessé d’évoluer au cours de cette histoire et encore maintenant, je ne suis pas certaine d’avoir une opinion bien tranchée sur elles.
Après un temps de méfiance et d’observation (un peu comme celui qu’il m’a fallu en commençant le roman avant de m’y absorber totalement), elles finissent par éprouver un étrange attachement profond, viscéral, sans concession. C’est une histoire fascinante. Touchante, puissante, intimiste, mais aussi terriblement dérangeante.
Au final, je ne vous ai pas dit grand-chose de ce qui m’avait fait tant aimer ce roman, mais à vrai dire, je ne le sais pas vraiment. Je me suis laissée happer, discrète spectatrice de cette amitié atypique et presque incompréhensible, de cette histoire violente et sombre, psychologiquement éreintante, qui m’a touchée au cœur sans que je puisse disserter du pourquoi du comment. J’ai lu ce livre avec mes tripes et il me reste en tête depuis.
« Je n’avais rien à répondre, ce qu’elle venait de dire n’était pas une nouveauté, elle ne concevait pas que notre affection réciproque lui faisait porter des coups qui me jetaient à terre. Justement parce qu’elle m’aimait et que moi aussi je l’aimais. Seuls ceux qui me sont proches peuvent me faire du mal, elle aurait dû le comprendre depuis longtemps, mais elle ne comprend que ce qu’elle veut bien. »
« Emerence réservait à chacun des récompenses différentes : elle tenait le lieutenant-colonel en haute estime, elle avait donné son cœur à Viola, son travail irréprochable était voué à mon mari – lui-même appréciait que la réserve d’Emerence restreigne dans des limites convenables ma tendance provinciale à sympathiser –, elle m’avait investie d’une mission à accomplir à un moment crucial à venir, et m’avait légué l’exigence que ce ne soit pas une machine ou la technique qui fasse osciller les branches, mais la véritable passion – c’était beaucoup, c’était même le plus important de ses dons, mais ce n’était pas encore assez, j’en voulais davantage, j’aurais aimé parfois la prendre dans les bras comme ma mère autrefois, lui dire ce que je ne dirais à personne d’autre, quelque chose que ma mère n’aurait pas compris par son esprit et sa culture, mais perçu grâce aux antennes de son amour. Cependant ce n’est pas ainsi qu’elle avait besoin de moi, du mois c’est ce que je croyais. »
La porte, Magda Szabó. Le Livre de Poche, 2017 (1987 pour l’édition originale. Editions Viviane Hamy, 2003, pour la traduction française). Traduit du hongrois par Chantal Philippe. 344 pages.
Challenge Voix d’autrices : un roman/une autrice ayant reçu un prix
***
Inside, d’Alix Ohlin (2012)
 Quand j’ai tiré ce livre de ma PAL, je ne savais rien sur lui au préalable, je n’en avais jamais entendu parler. J’y ai découvert une histoire humaine et sensible sur trois protagonistes aux vies entremêlées. Parfois c’est juste pour quelques mois, parfois c’est pour des années.
Quand j’ai tiré ce livre de ma PAL, je ne savais rien sur lui au préalable, je n’en avais jamais entendu parler. J’y ai découvert une histoire humaine et sensible sur trois protagonistes aux vies entremêlées. Parfois c’est juste pour quelques mois, parfois c’est pour des années.
Nous suivons donc Grace à Montréal en 1996, Anne à New-York en 2002 et Mitch entre Iqaluit et Montréal en 2006. La première, psychologue, trouve un homme dans la neige alors qu’il vient de tenter de se suicider ; la seconde vient en aide à une jeune fugueuse enceinte ; le dernier, thérapeute, part au-delà du cercle arctique, fuyant l’amour, le bonheur, la vie conjugale ou autre chose encore peut-être.
Quelques mois de la vie de ses personnages, racontés ici avec beaucoup de simplicité et de justesse. Je me suis retrouvée en Grace, je me suis retrouvée en Anne, et je me suis même parfois retrouvée en Mitch. L’action est pratiquement inexistante – ce sont les aventures, je ne dirais pas banales car ses trois protagonistes font des rencontres qui n’arrivent pas à tout le monde, mais réalistes d’une vie – ce qui laisse la place à une psychologie fouillée et complexe. Avec leurs faiblesses, leurs doutes, leurs forces, leurs qualités, Alix Ohlin nous présente des personnalités touchantes, parfois imparfaites, parfois exaspérantes sur certains points, mais toujours parlantes. Les connexions entre ces trois personnages – Grace étant au centre de cette symphonie humaine – nous permettent de les suivre sur près d’une décennie et l’autrice va réellement au bout des choses, au bout de ses histoires, sans jamais porter de jugements, mais avec beaucoup d’amour pour celles et ceux qu’elle a fait naître.
Une véritable plongée au cœur de la psyché humaine, des émotions et des événements qui agitent et bousculent nos vies actuelles. Un roman choral et intimiste porté par une belle écriture qui m’a bercée pendant quelques heures de lecture forte et émouvante.
« Grace avait passé sa vie à essayer de recréer chez elle la vie parfaite de ses parents. Qu’ils aient toujours paru le faire sans la moindre difficulté n’aidait pas. Il y avait un mystère inhérent à cette simplicité, à la facilité avec laquelle les choses fonctionnaient chez eux. Ils devaient être les gens les plus chanceux du monde. »
« Son seul et unique don, depuis l’enfance, était ce qu’on pouvait rêver de mieux, un don qui l’avait entouré toute sa vie, élastique, spacieux, capable d’inclure sa femme, leur famille, leur maison et même, quand il était là, son frère : il avait le don d’être heureux. »
Inside, Alix Ohlin. Gallimard, coll. Du monde entier, 2013 (2012 pour l’édition originale). Traduit de l’anglais (Canada) par Clément Baude. 362 pages.
***
Les derniers jours de nos pères, de Joël Dicker (2011)
 Alors que je lui avais dit que lire un autre Joël Dicker – autre que La vérité sur l’affaire Harry Québert que j’avais aimé à l’époque mais que je ne relirai probablement pas de peur d’avoir un avis tout différent – n’était absolument pas dans mes priorités, Le Joli (chou moustachu) m’a tout de même collé son premier roman dans les mains. Soit. Lisons-le.
Alors que je lui avais dit que lire un autre Joël Dicker – autre que La vérité sur l’affaire Harry Québert que j’avais aimé à l’époque mais que je ne relirai probablement pas de peur d’avoir un avis tout différent – n’était absolument pas dans mes priorités, Le Joli (chou moustachu) m’a tout de même collé son premier roman dans les mains. Soit. Lisons-le.
Londres, 1940. Churchill crée une nouvelle branche des services secrets : le SOE, composé de Français ou de parfaits francophones, se spécialise dans le sabotage et le renseignement. Au cours d’un entraînement rigoureux, le jeune Paul-Emile se fait des amis fidèles, liés par des événements uniques. Néanmoins, si l’amitié est belle, le quotidien le sera moins une fois sur le terrain lorsque leurs missions les amèneront à déjouer le contre-espionnage allemand.
Et finalement, j’ai été agréablement surprise. Ce n’est pas la lecture de l’année, le livre que je retiendrai de 2018. Le plus gros reproche que je lui ferai est d’être un peu trop facile, un peu trop prévisible : qui vit, qui meurt, l’évolution des personnages, le déroulement de l’histoire… On ne peut pas dire qu’on va tomber des nues à un moment ou un autre. De plus, je trouve que la narration peine à nous faire ressentir les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnages. La lecture est fluide et leur quotidien semble l’être tout autant. Tant pis. Non seulement ça n’empêche pas l’histoire de tenir en haleine – comment est-ce possible ? –, mais en plus ce livre a d’autres qualités.
Déjà pour la découverte du SOE (Special Operations Executive), organisation intéressante et longtemps tenue secrète. Si j’avais déjà entendu parler de ce service secret britannique, je l’avais oublié. Ça permet de raconter la Seconde Guerre mondiale sous un jour nouveau et, étant peu attirée par les romans sur les Guerres mondiales (légère saturation même si une fois dedans, je suis souvent bien attrapée), c’est un atout que j’apprécie beaucoup (le fabuleux roman Le sel de nos larmes avait déjà eu cette même qualité de parler d’un épisode méconnu de cette période). Autre point qui ne nuit jamais : les personnages sont tout de même très attachants. Gros, Stanislas… même le père qui m’a parfois agacée et parfois touchée tant il paraît à la ramasse. Si leurs caractères sont divers et choisis pour montrer différents types de comportement et de réaction face à l’Occupation et la guerre, plusieurs d’entre eux (et elle) sont plutôt bien développés, ce qui permet parfois de toucher à leurs défauts, à leurs peurs, à leurs erreurs.
Un roman historique qui se penche sur des éléments méconnus (de moi en tout cas) portés par des personnages intéressants : une lecture qui, si elle ne m’a pas autant bouleversée que d’autres lecteurs/lectrices, n’en reste pas moins sympathique.
« Alors Pal avait dévisage fixement Calland. Dans ses yeux brillait la lumière du courage, ce courage des fils qui font le désespoir de leurs pères. »
« L’indifférence est la raison même pour laquelle ne nous pourrons jamais dormir tranquilles; parce qu’un jour nous perdrons tout, non pas parce que nous sommes faibles et que nous avons été écrasés par plus fort que nous, mais parce que nous avons été lâches et que nous n’avons rien fait. »
Les derniers jours de nos pères, Joël Dicker. Editions De Fallois, coll. Poche, 2015 (2011 pour la première publication). 450 pages.

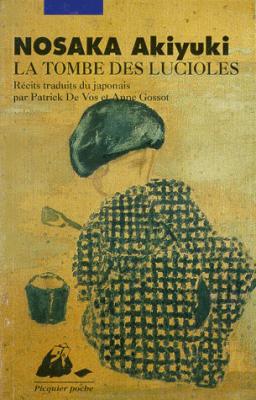 Le quotidien terrible de ces enfants est rendu palpable par les longues phrases qui convoquent les sens, même si ce n’est pas de la manière la plus agréable qui soit. Les aliments moisis, les odeurs corporelles, la crasse, l’urine et la diarrhée, les poux, les asticots et la gale, les sirènes assourdissantes des alertes aériennes, la cohabitation avec la mort et avec les morts… la réalité de la guerre prend aux tripes, écœure autant qu’elle désespère. Et puis, il y a cette ouverture affreuse dans laquelle Seita meurt seul, dans une gare, un fait qui semble totalement banalisé, pour les vivants autour de lui, par le lieu et l’époque.
Le quotidien terrible de ces enfants est rendu palpable par les longues phrases qui convoquent les sens, même si ce n’est pas de la manière la plus agréable qui soit. Les aliments moisis, les odeurs corporelles, la crasse, l’urine et la diarrhée, les poux, les asticots et la gale, les sirènes assourdissantes des alertes aériennes, la cohabitation avec la mort et avec les morts… la réalité de la guerre prend aux tripes, écœure autant qu’elle désespère. Et puis, il y a cette ouverture affreuse dans laquelle Seita meurt seul, dans une gare, un fait qui semble totalement banalisé, pour les vivants autour de lui, par le lieu et l’époque.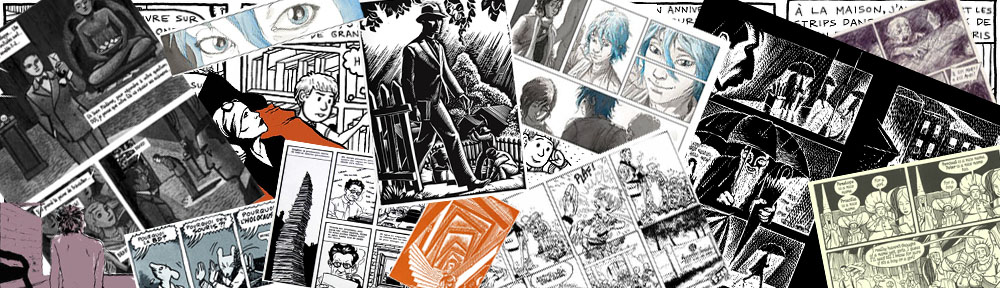
 Une œuvre connue sous pas moins de trois noms : D’entre les morts est le titre original du roman, Vertigo le titre original de l’adaptation par Hitchcoch et Sueurs froides le titre français du film qui est finalement devenu celui du livre.
Une œuvre connue sous pas moins de trois noms : D’entre les morts est le titre original du roman, Vertigo le titre original de l’adaptation par Hitchcoch et Sueurs froides le titre français du film qui est finalement devenu celui du livre. Je dois dire que je me suis interrogée tout au long de ma lecture sur ce qui avait attiré l’attention d’Hitchcock sur ce roman et je me devais de voir le film.
Je dois dire que je me suis interrogée tout au long de ma lecture sur ce qui avait attiré l’attention d’Hitchcock sur ce roman et je me devais de voir le film.
 Confession d’un masque est un livre que j’avais vraiment adoré étant adolescente. Les années passant et ma mémoire étant ce qu’elle est, tout ce qu’il me restait de cette lecture était ce sentiment. J’ai donc décidé de lui accorder une petite relecture avant d’explorer les autres romans de Yukio Mishima qui dorment dans ma PAL. Et si je ne l’ai pas adoré, j’ai tout de même beaucoup aimé cette lecture.
Confession d’un masque est un livre que j’avais vraiment adoré étant adolescente. Les années passant et ma mémoire étant ce qu’elle est, tout ce qu’il me restait de cette lecture était ce sentiment. J’ai donc décidé de lui accorder une petite relecture avant d’explorer les autres romans de Yukio Mishima qui dorment dans ma PAL. Et si je ne l’ai pas adoré, j’ai tout de même beaucoup aimé cette lecture. J’avais beaucoup aimé mes lectures de
J’avais beaucoup aimé mes lectures de 

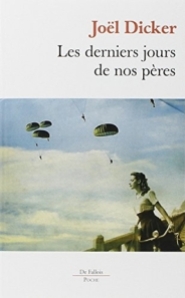
 Telle une longue confession de la narratrice, ce roman retrace sa rencontre et son amitié avec Emerence, une domestique à la fois concierge et bonne. Aussi différentes que possible, toutes deux vont nouer une relation unique.
Telle une longue confession de la narratrice, ce roman retrace sa rencontre et son amitié avec Emerence, une domestique à la fois concierge et bonne. Aussi différentes que possible, toutes deux vont nouer une relation unique. Quand j’ai tiré ce livre de ma PAL, je ne savais rien sur lui au préalable, je n’en avais jamais entendu parler. J’y ai découvert une histoire humaine et sensible sur trois protagonistes aux vies entremêlées. Parfois c’est juste pour quelques mois, parfois c’est pour des années.
Quand j’ai tiré ce livre de ma PAL, je ne savais rien sur lui au préalable, je n’en avais jamais entendu parler. J’y ai découvert une histoire humaine et sensible sur trois protagonistes aux vies entremêlées. Parfois c’est juste pour quelques mois, parfois c’est pour des années. Alors que je lui avais dit que lire un autre Joël Dicker – autre que La vérité sur l’affaire Harry Québert que j’avais aimé à l’époque mais que je ne relirai probablement pas de peur d’avoir un avis tout différent – n’était absolument pas dans mes priorités,
Alors que je lui avais dit que lire un autre Joël Dicker – autre que La vérité sur l’affaire Harry Québert que j’avais aimé à l’époque mais que je ne relirai probablement pas de peur d’avoir un avis tout différent – n’était absolument pas dans mes priorités, 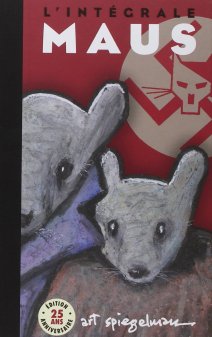 L’histoire de Vladek Spiegelman, Juif polonais ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah, raconté par son fils.
L’histoire de Vladek Spiegelman, Juif polonais ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah, raconté par son fils.






