La nouvelle saison du RDV « Les classiques, c’est fantastique » est officiellement ouverte !

Sologne, années 1920. Raboliot est un « braco » comme un peu tout le monde. Sauf que le jour où il se fait pincer, il refuse de se plier à la loi et de payer l’amende. C’est le début d’un jeu de chat et souris avec les gendarmes, gardes-chasse, propriétaire terrien.
Ce roman a été récompensé du prix Goncourt en 1925.
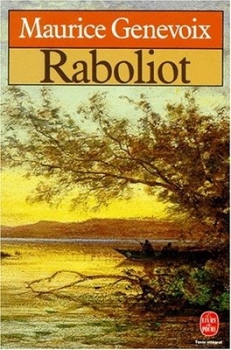 Il n’y a pas à dire, Genevoix s’y entend pour donner vie aux paysages à travers une écriture visuelle et poétique ! Omniprésente, la nature est décrite dans ses évolutions, ses variations au fil des saisons, le roman s’étalant sur un période de neuf-dix mois. Un matin givré, un sous-bois qui devient « un grimoire chargé de sens » sous les yeux de Raboliot, les étangs « bleus dans leur ceinture de roseaux jaunis », les taillis et les plaisses… Genevoix raconte aussi les animaux à plumes, à poils et à écailles et le rythme des activités humaines intégrées dans cet environnement. Tantôt accueillante, tantôt oppressante dès lors qu’une présence semble traquer Raboliot avec plus d’habileté que lui ; tantôt amie et protectrice, tantôt possiblement traîtresse. Le patois s’insère dans les dialogues, donnant vie à celles et ceux qui habitent ce coin de France, à travers un parler qui raconte un territoire et une classe sociale.
Il n’y a pas à dire, Genevoix s’y entend pour donner vie aux paysages à travers une écriture visuelle et poétique ! Omniprésente, la nature est décrite dans ses évolutions, ses variations au fil des saisons, le roman s’étalant sur un période de neuf-dix mois. Un matin givré, un sous-bois qui devient « un grimoire chargé de sens » sous les yeux de Raboliot, les étangs « bleus dans leur ceinture de roseaux jaunis », les taillis et les plaisses… Genevoix raconte aussi les animaux à plumes, à poils et à écailles et le rythme des activités humaines intégrées dans cet environnement. Tantôt accueillante, tantôt oppressante dès lors qu’une présence semble traquer Raboliot avec plus d’habileté que lui ; tantôt amie et protectrice, tantôt possiblement traîtresse. Le patois s’insère dans les dialogues, donnant vie à celles et ceux qui habitent ce coin de France, à travers un parler qui raconte un territoire et une classe sociale.
Malheureusement, mon plaisir s’est arrêté aux facettes les plus descriptives du roman. J’ai eu la bonne idée de l’emmener dans ma valise, comme seule lecture de vacances : si ça n’avait pas été le cas, je l’aurais probablement abandonné.
Je n’ai pas eu grande affection pour Raboliot. Oui, il exige sa liberté, écoute ses passions, ses désirs par-dessus tout, mais, dans sa révolte, je l’ai trouvé terriblement égoïste. Au-delà du fait que son « instinct de chasse » ne me convainc pas du tout, il n’a finalement aucun regard vers sa famille, sur la situation dans laquelle il la place. Oui, il se dresse contre la mainmise de quelques hommes sur un territoire, mais son rejet de l’autorité n’est en réalité que le produit de sa haine envers un seul homme, envers Bourrel, de son refus de se livrer à cet homme-là.
De plus, le regard porté sur les femmes est particulièrement misogyne. Sous la plume de Genevoix, le terme « sexe faible » prend tout son sens : globalement (avec sa femme, Sandrine, en tête), elles sont décrites comme geignardes, pleureuses, brimant les besoin naturels du chasseur, ne comprenant pas cette irrésistible pulsion.
« Sandrine ! Sandrine ! C’était bien elle, toujours faible et docile, toujours prête à plier sous une voix plus rude que la sienne, sous une volonté plus hardie. La pauvre proie, sans autre défense que ses larmes. Hélas ! Sur le désir ou sur la haine d’un homme, que peuvent les larmes de Sandrine ? »
Seules deux personnages féminins échappent à ce portrait larmoyant. Tout d’abord, la Flora, la catin, celle qui ne contrôle pas ses pulsions, celle dont les « prunelles brûlaient du feu hardi dont elle n’était point maîtresse », « une garce » pour qui « il suffisait qu’un homme la regardât pour qu’elle se couchât sur le dos ». Celle que Raboliot est bien content de trouver, mais qui finit par le dégoûter par le plaisir qu’elle semble y prendre. Certains passages sont d’un mépris hallucinant envers elle.
Ensuite, la fille de la Flora, Souris, victime des coups de son beau-père devenu ombre, celle qui court les bois pour le plaisir de la traque, celle qui joue des enjeux des adultes, celle qui se montre aussi insignifiante que menaçante.
Finalement, en filigrane, on finit presque par avoir un autre portrait de ces femmes : Sandrine avait finalement raison depuis le début et Flora est la seule qu’il l’accepte et l’héberge quand il se retrouve paria – la seule qui est déjà suffisamment à la marge pour se l’autoriser. Le tout est non-dit – je ne sais même pas ce qui se dégage réellement du récit en lui-même et ce qui vient de mes propres idées –, c’est donc insuffisant pour rattraper des pages de regard condescendant.
Certes, les descriptions des paysages, de la vie qui bruit autour du village, sont parfois superbes, mais c’est là un roman qui a, à mon avis, terriblement vieilli. Au contraire de bien d’autres classiques, il n’a su, en aucune manière, résonner en moi. Même si je suis toujours prête à tempérer des considérations sexistes au regard de l’âge d’un livre, j’ai tout de même trouvé les propos assez violents, d’autant que le reste de l’histoire ne m’a pas davantage convaincue.
« Mais le plaisir, hein ? Mais ce besoin de chasse nocturne qui vous empoignait tout à coup, parce qu’il pleuvinait dans les ténèbres épaisses, parce qu’il faisait clair de lune, parce qu’il avait neigé ? Du ciel familier, des terres natales, des appels mystérieux vous arrivent, des voix secrètes et connues, mille présences persuasives qui vous tirent, comme avec des mains, hors du lit.
Voilà : tous ces gens ne savent pas. Comment est-ce qu’il saurait, Bourrel, que le clair de lune est vivant, que son visage se montre à la fenêtre, se glisse à la fente des volets ou brille par terre sur le carreau ? Que le zinc d’une gouttière tintant aux gouttes de la pluie égrène une chanson parleuse ; et que le vent qui passe à la cime des pineraies, c’est une grande voix autoritaire à laquelle il est vain de vouloir désobéir ? »
« Dans le fond, il était resté gamin : quand on n’a guère plus de trente ans, malgré les cahots de la vie, malgré la guerre que l’on a faite, on sent monter en soi, certains jours, des poussées de jeunesse, des élans de gaîté plus vifs que des cabrioles. On ne cabriole pas, bien sûr, mais la gaîté vous brille aux yeux, y fait danser des étincelles. Et quand Bourrel s’en aperçoit, c’est lui qui frémit de colère. Et il serre les dents sans rien dire. Et il s’en va, montrant son dos boulu de muscles, qu’on devine sous le drap rêche contracté de mauvaise rancune. »
« Il n’y a qu’un recours, qui est de s’en aller ailleurs, d’aller chercher ailleurs des raisons d’être joyeux, de réchauffer en soi cette ardeur qu’y éveille la lutte, cette fierté de beau joueur en quête d’applaudissements. C’était malheureux à dire : le seul endroit au monde où Raboliot se sentait mal à l’aise, c’était sa propre maison, c’était l’air où respiraient les créatures qu’il aimait le mieux. Encore des choses difficiles à comprendre, et pourtant vraies, comme la souffrance qu’elles apportaient. »
« Mais il pressait le pas, d’instinct, comme si des regards l’eussent suivi en effet, dardés d’ici et puis de là, on ne savait de quel côté entre es petits arbres blancs. Les bouleaux étaient très serrés : ils se haussaient d’un jet vertical, jaillissaient comme des fusées grêles vers la lumière d’un ciel blafard. Raboliot à présent courait presque, dans une hâte d’être ailleurs, hors de ce taillis grelottant, de ne plus entendre alentour ces crépitements menus et furtifs, comme de brindilles brisées au passage d’un être vivant. Une branche craqua, un peu plus fort. Il s’arrêta tout net, se retourna, se frotta les yeux : décidément il avait la berlue ! Rien ni personne ne remuait plus à la place où il avait cru voir… Mais qu’est-ce qu’il avait cru voir ? C’était de couleur sombre, cela flottait comme une fumée, ou se traînait à ras de terre, il n’avait pu bien distinguer. Un vertige léger balançait les bouleaux trop pâles, toutes ces écorces plus blanches que des linges : un écœurement presque physique en venait à Raboliot. Par hasard, il abaissa les yeux vers sa chienne, et il la vit qui hérissait le poil, qui troussait les babines en grondant à fond de gorge. Elle aussi, alors ? »
Raboliot, Maurice Genevoix. Le Livre de Poche, 1991 (1925 pour la première publication). 284 pages.


 Le temps est venu pour Germain, jeune (enfin, pas pour l’époque) veuf de vingt-huit ans et père de trois enfants, de songer à se remarier, comme l’y incite gentiment sa belle-famille. Ça tombe bien, une femme semble convenir parfaitement dans un village voisin. La chose est arrangée : Germain ira lui rendre visite et en profitera pour escorter la petite Marie, seize ans, qui doit se faire bergère non loin de là. Sauf que le trajet ne sera pas aussi paisible et linéaire que prévu.
Le temps est venu pour Germain, jeune (enfin, pas pour l’époque) veuf de vingt-huit ans et père de trois enfants, de songer à se remarier, comme l’y incite gentiment sa belle-famille. Ça tombe bien, une femme semble convenir parfaitement dans un village voisin. La chose est arrangée : Germain ira lui rendre visite et en profitera pour escorter la petite Marie, seize ans, qui doit se faire bergère non loin de là. Sauf que le trajet ne sera pas aussi paisible et linéaire que prévu.

