 Véronica est culturiste. Son corps est son outil de travail, ses journées sont millimétrées, tout est planifiée : une compétition dans trois mois la fera passer élite. Sauf que. Un grain de sable dans la machinerie bien huilée. Un grain de sable non négligeable pour qui évalue ses repas au gramme près : une pâtisserie.
Véronica est culturiste. Son corps est son outil de travail, ses journées sont millimétrées, tout est planifiée : une compétition dans trois mois la fera passer élite. Sauf que. Un grain de sable dans la machinerie bien huilée. Un grain de sable non négligeable pour qui évalue ses repas au gramme près : une pâtisserie.
Tout d’abord, outre l’attrait d’un livre des éditions iXe, il y a eu la fascination pour un monde si différent du mien, si nouveau et inconnu. Pendant que je lisais sur mes pauses repas au boulot, me nourrissant de gâteau, Véronica pesait ses aliments, se contentait de poulet fade, de feuilles d’épinard et de shake de protéines. Bref, un gouffre entre nous. J’ai été sidérée par cette vie de contrôle, d’astreinte et de mental d’acier. L’obstination et la volonté, les entraînements matin et soir, le jeu des sponsors, les concours qui jugent en quelques secondes le travail de plusieurs mois, les sacrifices côté vie personnelle, etc. : ce roman est une véritable plongée dans le monde des bodybuilders. Et je vous le garantis, c’est captivant.
Puis, au fil de cette écriture belle et agréable, je me suis investie, passionnée par ses trajectoires de femmes surtout : Véronica, Carmélia, Lily (un tout petit peu), et puis Nico aussi. Des personnages qui touchent, agacent parfois mais émeuvent souvent. Des forces qui cachent des rêves, des doutes, des failles, des erreurs de trajectoires, des jeux d’équilibristes pour ne pas tomber, pour continuer à avancer. Les protagonistes sont creusés, complexes, imparfaits. Réalistes.
Et finalement, le corps de tous ces personnages – et pas seulement celui de Véronica – forme le cœur du récit. Qu’il soit maîtrisé ou incontrôlable, qu’il aime ou souffre, qu’il s’écrase ou flamboie, il se retrouve souvent dans les thématiques de ce roman très actuel. Je ne détaillerai pas ces sujets pour vous laisser le plaisir de la découverte.
Cependant, à côté du corps, il y a aussi l’esprit. L’esprit qui se fait moteur mais qui peut se transformer en arme. L’esprit qui peut être la plus grande des forces mais le plus impitoyable des ennemis. L’esprit qui taraude, qui pose cette question lancinante : qui suis-je ? qu’est-ce qui me remplit ? qu’est-ce que je fais là ?
Au-delà de cet univers spécifique qui peut sembler si étranger, ce sont donc des questionnements universels qui émaillent ce roman, des interrogations qui ont résonné en moi comme elles pourront résonner en vous.
Une tranche de vie, un zoom sur quelques humain·es, des personnages forts, un roman riche et nuancé, une lecture fascinante et poignante à la fois. Une très jolie découverte.
« Mais par-dessus tout c’est la tête, c’est le mental, c’est la théorie de la mémoire musculaire appliquée au cerveau. C’est une question d’habitude. A force de réprimer sa faim, ses envies à longueur de journées, de semaines, de mois, on prend le pli. La discipline devient une seconde nature. On ne s’en rend même plus compte – jusqu’au jour où quelqu’un, enfin, rétablit le contact, bout des doigts sur courbe de la taille, et là on constate qu’à oublier sa faim, on a perdu l’appétit. On a perdu l’habitude d’être touchée comme ça. »
« Et je continue. C’est si clair en moi que je peux presque voir mon esprit s’approcher de la rambarde, de la falaise, de la barrière. Prendre son élan et sauter. »
La dernière fois que j’ai cru mourir c’était il y a longtemps, Clémence Michallon. Éditions iXe, coll. iXe’ prime, 2020. 312 pages.

 Voilà un sujet que j’ai déjà abordé sur le blog suite à ma lecture de deux autres livres écrits par Eliane Viennot et publiés aux éditions iXe, à savoir
Voilà un sujet que j’ai déjà abordé sur le blog suite à ma lecture de deux autres livres écrits par Eliane Viennot et publiés aux éditions iXe, à savoir 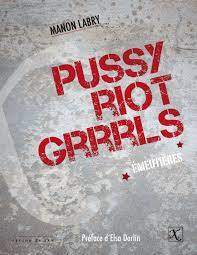 Des Riot Grrrls américaines du début des années 1990 aux Pussy Riot russes des années 2010, ce livre retrace l’histoire féministe et révoltée d’un mouvement punk et DIY qui aura connu, au fil des décennies, de multiples mutations et réappropriations par des femmes du monde entier.
Des Riot Grrrls américaines du début des années 1990 aux Pussy Riot russes des années 2010, ce livre retrace l’histoire féministe et révoltée d’un mouvement punk et DIY qui aura connu, au fil des décennies, de multiples mutations et réappropriations par des femmes du monde entier.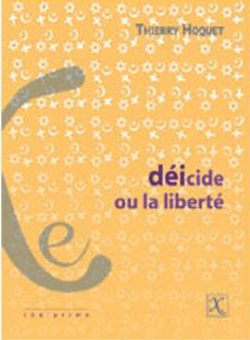 Dans
Dans  La campagne présidentielle est lancée. Un jour, un homme s’interroge : pourquoi tous les présidents français sont-ils des hommes blancs hétérosexuels ? Pourquoi pas de femmes, pas de Noirs, pas de homos, pas de végétariens ? La France tend l’oreille vers cet électron libre, Ulysse Riveneuve, qui propose une idée : supprimer le sexe des actes civils. Devenu candidat, c’est là son seul programme. Ce simple fait – cesser de sexualiser les individus et de les formater dès la naissance à « agir en fille » ou à « agir en garçon » selon leur entrejambe – autorisera enfin une véritable égalité entre toustes quel que soit leur sexe, leur origine, leur sexualité. Cette idée, séduisante pour certain.es, irritante pour d’autres, se retrouve rapidement au cœur de débats passionnés.
La campagne présidentielle est lancée. Un jour, un homme s’interroge : pourquoi tous les présidents français sont-ils des hommes blancs hétérosexuels ? Pourquoi pas de femmes, pas de Noirs, pas de homos, pas de végétariens ? La France tend l’oreille vers cet électron libre, Ulysse Riveneuve, qui propose une idée : supprimer le sexe des actes civils. Devenu candidat, c’est là son seul programme. Ce simple fait – cesser de sexualiser les individus et de les formater dès la naissance à « agir en fille » ou à « agir en garçon » selon leur entrejambe – autorisera enfin une véritable égalité entre toustes quel que soit leur sexe, leur origine, leur sexualité. Cette idée, séduisante pour certain.es, irritante pour d’autres, se retrouve rapidement au cœur de débats passionnés.