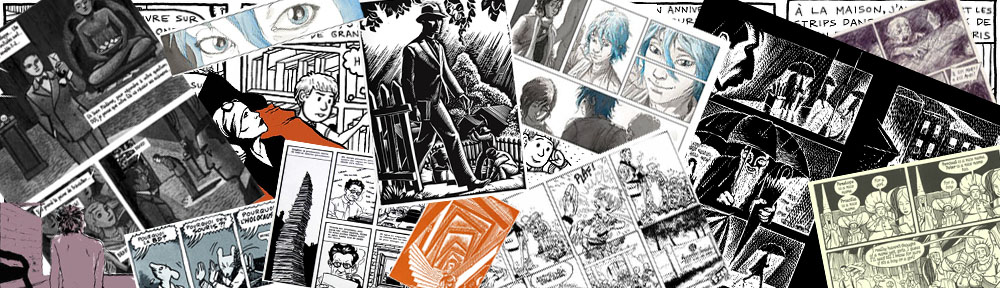Sur le blog des éditions Dodo Vole (maison d’édition réunionnaise), voilà ce qu’il est dit à propos de ce roman : « Nénuphars, navigations, nourritures et malentendus : le nouveau roman de Johary Ravaloson ne se laisse pas facilement résumer. » Nous voilà bien avancés. Une seule chose à faire : se plonger dans le livre.
Sur le blog des éditions Dodo Vole (maison d’édition réunionnaise), voilà ce qu’il est dit à propos de ce roman : « Nénuphars, navigations, nourritures et malentendus : le nouveau roman de Johary Ravaloson ne se laisse pas facilement résumer. » Nous voilà bien avancés. Une seule chose à faire : se plonger dans le livre.
Et j’ai découvert une écriture toujours très fluide, parfois très poétique.
Elle nous promène entre deux histoires, entre deux époques. Celle d’Ietsé, le premier homme à fouler la terre de « l’île rouge » selon la légende. Celle d’Ietsé Razak, son descendant, qui souffre d’insomnies. De nombreux retours en arrière nous font également revivre le passé d’Ietsé Razak : sa naissance dans une famille très riche, ses études de droit en France, sa mésaventure amoureuse avec Ninon, son retour au pays, son mariage avec Léa-Nour… Toutes ces histoires et légendes étroitement entrelacées sont parfois déroutantes pour le lecteur : tout est prétexte à un voyage dans le temps.
On aperçoit évidemment Madagascar et sa capitale, Antananarivo, « la Ville aux mille ambiguïtés » pour l’auteur, où la richesse extrême de quelques-uns côtoie la pauvreté et la misère de tous les autres. Sont également évoquées les difficultés liées à la situation d’immigré en France.
Pris au hasard dans une librairie, ce livre est une très plaisante découverte que je conseille à tous ceux qui souhaite un petit voyage à Madagascar.
« Néanmoins, le faste de l’endroit embarrassa les membres du cercle, artistes et intellectuels du dessus du panier pourtant, dès la première réunion. (…) L’accueil guindé de la vieille gouvernante, qui, malgré les consignes de simplicité de sa maîtresse, ne savait ou ne voulait pas faire moins, les domestiques qu’on ne pouvait cacher, les couverts et les meubles qu’on ne pouvait changer contre des plus modestes, le plafond haut où brillaient les lustres, les saisirent. Ils savaient les Razak riches, ils ne pouvaient cependant imaginer cela, eux, logeant à l’étroit en ville dans des maisons, pour les plus chanceux héritées et louées en partie, mais pour tous en état de délabrement, qu’aucun n’avait les moyens de restaurer, grignotant les moindres économies pour assurer l’éducation des enfants, leur habillement, oui, même pour leur nourriture, certains avec une part des mets de la table dressée « à la bonne franquette » d’Anosisoa auraient bien aimé égayé le riz blanc familial chez eux pour le restant de la semaine, ils vivaient l’endettement du pays dans leur propre vie, c’est-à-dire travaillant dur mais récoltant à peine assez pour survivre, ils ne pouvaient tout simplement pas concevoir cette magnificence. »
« Et, comme on dit, Angano angano, Arira arira, une légende est une légende, la vérité en est une autre, ce n’est pas moi qui mens mais ceux qui me les ont transmises. »
Les larmes d’Ietsé, Johary Ravaloson. Dodo Vole, 2012. 136 pages.