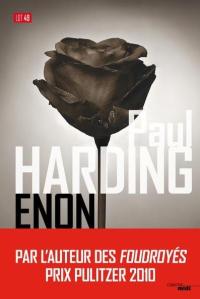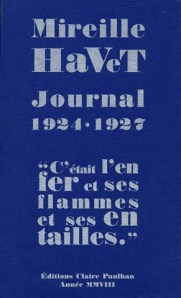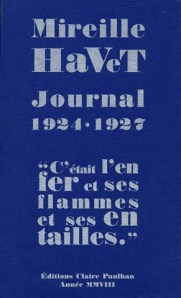 Voici la suite du journal de Mireille Havet qui couvre donc la période 1924-1927. Le fil conducteur est son histoire avec l’ancien mannequin, Reine Bénard. Grandeur et décadence d’un amour passionné.
Voici la suite du journal de Mireille Havet qui couvre donc la période 1924-1927. Le fil conducteur est son histoire avec l’ancien mannequin, Reine Bénard. Grandeur et décadence d’un amour passionné.
Mireille Havet, après s’être séparée de Madeleine de Limur, puis de Marcelle Garros, connaît un amour fou pour Reine : elle parle de félicité, de « bonheur si profond » ; rien ne semble pouvoir entacher cette joie même si la drogue fait toujours partie de son quotidien, la morphine notamment. Elle raconte l’amour passionné, moite, fiévreux, celui qui harasse et brise de plaisir ; elle dit la sensualité, le désir, l’excitation, l’exacerbation des sens. Elle retranscrit parfaitement la tension induite par l’amour inassouvi et fait subir cette impatience au lecteur. Elle parle de sa sexualité sans mystère, sans mensonge, mais avec douceur et passion. Nous sommes en 1926 certes, mais il ne faut pas oublier qu’elle ne destinait pas son journal à la publication, qu’elle écrivait pour elle-même et qu’elle n’avait donc pas besoin de sacrifier à la morale et à la bienséance. Malgré son amour, Mireille est parfois versatile : un jour, folle de joie et d’amour, le lendemain, triste, las de tout, elle se sent seule, sans amour et pense au suicide. La mort n’est jamais loin : « Rien n’est plus près de l’amour que la mort. »
Cependant, leur histoire se délite. Reine, partie en cure de désintoxication, est considérée comme une menteuse et une traîtresse : le portrait de celle que Mireille couvrait de fleurs et de compliments devient noir. Des phases de rage et de violence – contre Reine et contre elle-même – précèdent des phases d’apathie totale et de désespoir. Elle ressemble à un animal blessé et quiconque a déjà connu ces sentiments ne peut rester indifférent devant sa douleur. Elle pense au suicide, menace Reine de le faire. Blessée au plus profond d’elle-même, elle trouve un exutoire dans les malédictions qu’elle profère (« Reine Bénard, que votre nom que j’exècre et maudis de toute mon âme (à l’égal de tout ce qu’il y a de plus bas et immonde sur la terre et dans la boue de cette terre quand elle est piétinée par des naines comme vous) (…). Votre nom de petite bourgeoise suffisante et stupide, le voici cloué dans ce livre, à jamais incorporé à ma mort, et stigmatisé par elle. »). Elle fait preuve d’un mépris sans nom pour Reine. Si elle a pu effectivement être dupée par son amour, abusée par la passion inspirée par cette bourgeoise « nulle en tout, sinon dans l’art de s’habiller », ces caricatures parfois comiques dissimulent surtout – selon moi – une douleur immense. Quoi qu’il en soit, les portraits qu’elle trace de la pauvre Reine ne sont vraiment pas flatteurs. Mireille fait également preuve d’un peu d’hypocrisie en expliquant que son seul intérêt pour Reine venait du fait que celle-ci l’entretenait, ce qui n’est pas faux, mais ce n’est pas la seule raison : on ne souffre pas ainsi pour un simple distributeur de billet.
« La morphine vous rendait non seulement ce que vous n’êtes plus, dépouillée d’elle et rendue à votre indigente et lamentable petite identité humaine, c’est-à-dire supportable, mais même, elle vous donnait une apparence de personnalité à laquelle de plus intelligents que moi pouvaient très bien se prendre, un semblant d’esprit enfin, toute une vie intérieure, mystérieuse et, par cela même, attirante, qui pouvait faire croire à votre vraie valeur individuelle et parfaitement vous faire aimer. »
Son journal est une exacerbation de chacun de ses sentiments et de ses émotions, de son amour comme de son malheur. Elle m’a semblé moins rationnelle, plus à fleur de peau parfois que par le passé, ce qui s’explique peut-être par la perte de Reine, de sa mère, de Marcelle Garros en peu d’années. Elle avait cru avoir trouvé en Reine une compagne qui resterait, qu’elle aimerait toujours et, quand celle-ci est partie, elle s’est sentie abandonnée, aussi seule qu’elle l’a toujours été, aussi seule que l’est la majorité des hommes : « Je pense, je pense, et personne ne me soutient moralement. N’est-ce pas là le signe que personne n’a à nous soutenir ? ». Elle prend conscience de sa solitude, de sa condition d’orpheline : « Pour la première fois, je me sens (ce que je n’ai au fond jamais cessé d’être) réellement perdue sur la terre… et orpheline de père et de mère. »
Elle connaît également des périodes de dévalorisation. Si certains éléments ne sont que la preuve d’une lucidité, d’une connaissance d’elle-même, ce n’est pas toujours le cas et se diabolise plus que de raison. Elle se décrit comme « l’intoxiquée type de naissance » avide d’argent, vénale, incapable d’amour s’il n’est pas motivé par l’argent. Elle se décrit comme un corps toxique, menteur, manipulateur, amoral. Elle dénigre ces écrits – nouvelles, poèmes, roman – qui ne sont que des « constructions d’intoxiquée » sans intérêt. Elle fut dure envers Reine, elle le fut autant envers elle-même.
La drogue fait partie de son quotidien. A plusieurs reprises et avec une incroyable précision et une réelle lucidité, Mireille décrit les réactions de son corps et de son esprit lorsqu’elle est en manque et lorsque, enfin, elle reçoit sa dose. Mais elle tente s’en délivrer. Elle essaie de se désintoxiquer seule, c’est un échec. En 1926, elle décide de rentrer à Saint-Cloud et de « tenter [sa] chance dans une voie nouvelle et que l’on appelle la santé ». Elle sent la menace, la mort qui approche si elle ne se défait pas de ses addictions. Le 4 septembre 1926, elle écrit :
« … je suis venue ici, me jugeant, avec raison d’ailleurs d’après les révélations qui m’avaient été faites, à demi-guérie et sur le facile chemin de la guérison complète et encore solitaire. Là, je me leurrais vraiment. On progresse, mais on ne s’évade pas seul entièrement… et alors, on retombe. Ce fut mon histoire monotone, au fond, et perpétuelle avec toutes les drogues, choisies successivement et toujours pour me sortir de la précédente, depuis quatre ans.
Maintenant, je ne puis plus retomber. Si je retombais, je deviendrais gâteuse ou folle, ou je mourrais prochainement.
Je ne puis plus que renoncer à moi-même, à ma vie, à mon travail, à mon ambition, à mon devoir, ou me vaincre et guérir. Je guérirai. »
Son journal est toujours aussi fort et juste. Comme Stefan Zweig le faisait dans ses nouvelles, Mireille Havet expérimente des émotions et les détaille, les analyse en profondeur pour se comprendre et comprendre les autres. Elle poursuit sa route, entre vie et mort, entre amour et haine, sans savoir qu’elle ne sera qu’une étoile filante qui n’aura pas le temps de faire entendre sa voix. Elle avance dans cette « féerie grotesque » qu’est la vie.
Les seuls moments où j’ai senti une différence d’époque et de milieu social entre nous sont ceux où elle décrit sa vie dans les hôtels et palaces (d’Annecy par exemple). A l’évocation de cette haute société, de cette bourgeoisie, je me détachais et prenait ses passages davantage comme la découverte d’une autre société, d’une autre époque.
Son agenda côtoie son journal à partir de 1927. Ces notes télégraphiques ne disent que quelques mots sur son quotidien, le déroulement de sa journée (repas avec Untel, prise de drogue, déplacement chez Une Telle, un mot sur son humeur, etc.). Le style tranche à côté du flot de pensées, de sensations, déversé dans son journal.
Journal 1924-1927 : « C’était l’enfer et ses flammes et ses entailles », Mireille Havet. Editions Claire Paulhan, coll. Pour mémoire, 2008. 445 pages.
Les autres chroniques sur Mireille Havet
 Le seul et unique Ivan, narrateur de cette histoire, est un gorille, un « dos argenté » qui vit avec Stella la vieille éléphante et Bob le chien errant dans un mini cirque qui « reste au même endroit, comme une vieille bête trop fatiguée pour bouger », installé dans un centre commercial américain. Ivan s’est habitué à son « domaine » (comme il appelle sa cage), à la télévision, aux yaourts au raisin et à Mack, leur chef. Et puis il a le dessin et Julia la fille du gardien qui l’encourage. Mais la tristesse de la petite Ruby, une jeune éléphante qui vient de les rejoindre le pousse à rechercher autre chose, à leur trouver une nouvelle vie.
Le seul et unique Ivan, narrateur de cette histoire, est un gorille, un « dos argenté » qui vit avec Stella la vieille éléphante et Bob le chien errant dans un mini cirque qui « reste au même endroit, comme une vieille bête trop fatiguée pour bouger », installé dans un centre commercial américain. Ivan s’est habitué à son « domaine » (comme il appelle sa cage), à la télévision, aux yaourts au raisin et à Mack, leur chef. Et puis il a le dessin et Julia la fille du gardien qui l’encourage. Mais la tristesse de la petite Ruby, une jeune éléphante qui vient de les rejoindre le pousse à rechercher autre chose, à leur trouver une nouvelle vie.



 ils nous coincent entre eux, nous étranglent, nous étouffent.
ils nous coincent entre eux, nous étranglent, nous étouffent.